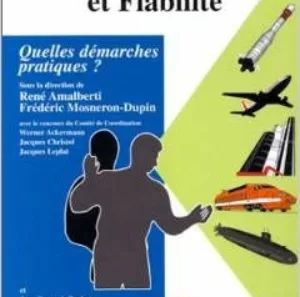De l’erreur des comparaisons internationales au sein des Grandes entreprises !
L’objectif du zéro accident prend ses origines à divers endroits et à différents moments. Il reste difficile de faire le tri pour parvenir à un Graal dont tout le monde parle. Sans recette aucune, je vous adresse mon avis sur ce sujet. Vous pourrez consulter également des articles plus anciens).
Sinistre corporel au travail – un concept vague au niveau international
L’objectif du Zéro accident prend corps dans les Groupes internationaux. Si vous êtes dans cette situation, on constate très vite que les statistiques Tf et Tg sont incomparables entre les pays. Si en Europe, nous ne sommes déjà pas alignés. Au-delà, il devient plus qu’hasardeux de vouloir comparer l’accidentologie.
L’accident du travail et sa définition ont associés à la protection sociale / assurance en place dans le pays. Aussi, lorsque l’on sait l’ouverture de notre sécurité sociale française et la présomption d’imputabilité, il est plus aisé de comprendre les écarts potentiels constatés avec les autres nations.
Une entreprise peut définir une règle pour toutes ses sociétés peu importent leurs implantations. Toutefois, la culture locale prend le dessus tout autant que la sécurité (en termes d’emplois) des salariés.
Vous pouvez consulter : Eurogip / AISS
Sinistre corporel au travail – obérer l’Homme et ses imperfections
Vouloir le « zéro accident » est un objectif louable et la suite logique dans une démarche de prévention. C’est une vision plutôt qu’un objectif d’ailleurs, puisque le résultat sera le fruit d’un certain nombre d’étapes validées et de jalons passés avec succès.
Le zéro accident à tout prix est à considérer selon les organisations et les types d’activités.
Le facteur incontournable et central reste l’Homme et son activité quotidienne (qu’elle soit professionnelle ou personnelle). Oui, il est illusoire de vouloir entamer une démarche « zéro » sans considérer (et sans travail de fond) sur le lien vie pro / vie perso.
L’Homme est faillible et ses distractions peuvent avoir des origines au travail comme dans son environnement personnel (fatigue en ces temps de forte chaleur, membre de sa famille en mauvaise santé, prise de traitement médicamenteux, accident de la vie, routine dans le travail, refus d’un congé, …) Tout ces éléments s’entrechoquent et font qu’à un moment, ou un autre, on décroche de son activité. Le corps est présent mais moins l’esprit.
Aussi, atteindre le zéro accident passe par un travail long et semé d’embûches sur la confiance réciproque (entreprise / employé).
Une démarche poussée par des cabinets de « conseil » (plus vendeurs que conseillers !)
Le concept « zéro accident » s’est peu à peu imposé au sein de grandes entreprises à travers la prise en compte de l’humain dans les rapports annuels aux actionnaires. Une motivation positive, au départ, mais qui a dérivé sur le « à tout prix » dans trop d’exemples.
Pour autant, certains confrères, cabinets en organisation du travail et prévention, accompagnent avec des outils magiques les entreprises vers le zéro accident. L’outil est plus facile à mettre en œuvre que le diagnostic qui permet de chercher le dysfonctionnement.
Aussi, selon sa maturité, l’outil est un moyen utile mais qui restera fondamentalement lié à la volonté de travail en profondeur de l’actionnariat / du DG.
Le zéro accident : atteignable ?
Diagnostiquer : Allo Docteur !
Pour mémo, les enjeux de la prévention des risques professionnels se situent sur plusieurs axes :
- Humains
- Économiques
- Juridiques
Quelques-uns ajouteront l’image et le commercial. Les deux points sont inclus, selon moi dans les enjeux humains et économiques voire juridiques par l’impact/ influence potentiel à travers les médias.
L’erreur serait de considérer l’enjeu principal comme étant économique ou juridique. Ces deux enjeux sont la conséquence du premier qu’est l’humain. L’événement non souhaité, dès lors qu’il touche l’Homme est ce qu’il faut traiter.
Traiter l’accident, c’est un peu comme un film de série « z » qui s’évertue à donner des médicaments repoussant les effets d’une maladie sans jamais rechercher véritablement, ni traiter les causes profondes.
Une seconde erreur des démarches actuelles portées par de trop nombreux cabinets est cette approche standardisée venant d’une conception nord-américaine. N’oublions pas que ces bases sont liées aux industries à risques ainsi qu’à une vision manquant d’approche fiabiliste autour de l’Homme. Ces orientations sont également associées à une approche anglo-saxonne de la prévention des risques très différente de notre culture européenne.
Il convient donc de poser un diagnostic avant de proposer des voies de travail. Cette évaluation doit porter autant sur les pans traditionnels que culturels de la démarche de prévention.
Ces deux aspects ne doivent surtout pas s’opposer. Ils sont complémentaires. Certes, les préventeurs sont souvent plus à l’aise avec l’un de ces axes. L’approche traditionnelle est technique ; on y évoque la conformité, la formation, le suivi / contrôle, la certification éventuelle. Quant à la seconde, l’approche culturelle est organisationnelle avant d’être managériale ; elle doit évaluer le fonctionnement réel d’une organisation et des managers vs ce qui est prescrit. C’est souvent dans cette zone que les freins au développement d’une culture de prévention sont identifiés.
Oui à travers un programme de développement de la culture de la prévention
Le programme de développement d’une culture de prévention est indissociable de l’objectif « zéro ». J’incite mes interlocuteurs à supprimer le terme accident et de conserver cette vision zéro blessure. Quand on travaille dans une industrie manufacturière, le sujet des maladies professionnelles et de l’usure sont tout autant centraux que l’accident !
Ce programme est nécessairement issu du paragraphe précédent. Et ce diagnostic prend du temps et demande un haut niveau de confiance entre celui-celle qui le réalise et l’entreprise.
Dans ce cadre, il est possible de construire un programme.
Au-delà de l’audit et du constat, il est primordial de commencer un programme de ce type par une période d’échange avec l’équipe de direction. Ce moment privilégié permet d’exprimer les perceptions négatives autant que positives des acteurs/actrices principaux. Il a surtout pour vertu d’engager cette équipe face à ses propres contradictions dans ses objectifs.
Et, seulement ensuite, le programme avec des jalons se traduit en étapes chronologiques !
Non si l’outil est le seul attendu et/ou si l’on évacue un pan de la prévention !
Deux oppositions principales, de mon avis, à l’atteinte du zéro accident. Le premier est le copier-coller d’un outil qui « marche ailleurs ». Le second se base sur l’absence de considération des leviers de la prévention (traditionnels / culturels).
L’outil passe-partout : Je continue à constater la mise en place des visites de sécurité à tout va, quelle que soit l’entreprise et sa maturité en prévention. J’en parlais indirectement dans l’article précédent « l’outil ou l’envie », il est inconcevable de poser un outil dans un environnement sans l’adapter au vécu de l’entreprise.
Oublier un pan de la prévention
L’approche purement technique de la prévention a encore quelques adeptes. Mettre en œuvre les formations obligatoires, effectuer les vérifications périodiques, accueillir et former les nouveaux, rédiger des plans de prévention, …, et finalement tout doit bien se passer. Les limites sont très souvent le manque d’engagement de l’encadrement. Dans cette dimension, la prévention reste le sujet de quelques-uns.
A contrario, faire fi des standards qui s’imposent à nous est dangereux pour les Hommes autant que les organisations. Ne pas réaliser de formation à la conduite d’engin, conserver des équipements hors d’usage (avec des problèmes de conformité), faire le minimum sur les visites périodiques. Tout ceci ne peut être compensé avec une démarche axée sur les Hommes et l’organisation. Il n’est pas possible d’être attentif en tout temps, tout ne s’apprend pas sur le tas,…
En conclusion
Atteindre la culture de prévention doit se voir selon son secteur d’activité et sa culture d’entreprise. Il est inopportun d’agir uniquement par le biais de formation sans se soucier du cœur de l’organisation dans laquelle on intervient. Le secteur d’activité, les fondateurs/actionnaires sont aussi importants que le pays pour une approche de prévention
Notre force, chez Griphe, est de travailler concrètement avec vous au préalable à tout accompagnement. Mes relais du blog en Afrique, en Amérique du Nord et dans toute l’Europe montrent cette importance et cette richesse de la prévention.
Pour une vision zéro blessure responsable !
Jérôme
Inspiration d’un article sur ce sujet publié en avril 2019 /